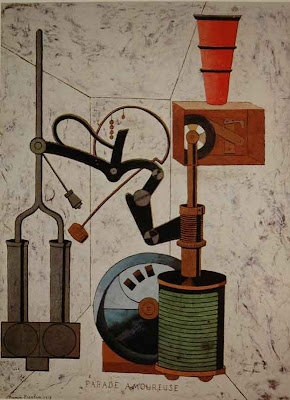Imogène Aseitas

Longtemps j’avais couché l’univers entier dans un songe. De bonne heure je me figurais tous les êtres comme les créatures de mon esprit. Je m’étais persuadé que rien n’existait que mon imagination n’ait créé et que l’étoffe du monde n’était que le tissu chamarré de mes affects filant sur la trame de ma volonté.
Car mon esprit est la substance de tous les êtres de la Création, du plus petit grain de poussière à la plus haute montagne, de l'amibe à l'éléphant, tous les êtres sont pétris dans la même pâte universelle; dans l'argile de ma volonté, humectée de l'eau des rêves; toute gonflée de l'air de mes songes; et il n'y avait rien qui ne fut cuit dans le feu ardent de Celui-qui-est.
Toutes mes créatures mettent à exister une insistance proportionnée au vouloir créateur. Parmi elles, il en est une qui surpasse les autres en perfection; voici l'homme.
J’ai si bien fait les hommes à mon image que, incapables de reconnaître ma divinité, ils me voient pour un des leurs. Je les aime comme moi-même. Et réciproquement, ils m’aiment comme si j’étais l’un deux, c’est à dire fort mal ; ma famille, mes collègues, mes amis, aucun d’eux ne saura jamais voir en moi la source du Grand Tout, et si je le leur avouais ils me tiendraient pour un fou et me rejeteraient dans l'indignité. A l'instar de ma puissance créatrice, l’esprit humain s'interroge sur l'origine du monde et invente des réponses pour broder la grande fable du monde. Du plus débile au plus génial, chaque homme ressasse sa vérité du monde qui dans sa Bible, qui dans ses livres, qui dans les Mythes ou dans ce qu'ils appellent la science, la plus raffinée de leurs mythologies.
De cette conscience initiale, chauffée dans l’extase océanique, de ces feux aveuglants expansés dans une nuit liquide et salée, de la puissance primitive de ma créativité des grands débuts, il ne reste qu’un substrat narratif, très vague et refroidi. Mais il est omniprésent et également réparti dans toutes directions de la conscience cosmique. Du récit élémentaire, le fragment le plus net me fait encore entendre l’écho des battements de mon cœur distordu par la nuit des espaces liquides et salés, renvoyé dans l’ample nuit liquide et salée couleur de sang à travers laquelle mon cœur battant jubilait d’entendre son écho amplifié et ralenti ; de l’écho puissant de mon cœur, prémice d’une conscience de soi le souvenir s'est presque éteint. Dans l'espace confondu de la mémoire et du présent, cet écho si faible dans la gelée des espaces noirs et salés, cet objet ténu de la mémoire n'est peut être qu'une construction humaine.
Je n’avais jamais cru qu’en moi-même. Je fis donc l’homme à mon image.
Moi qui vit au milieu des hommes, qui me fit homme parmi les hommes et qui suis leur égal car je ne leur ai jamais fait sentir ma divinité, je tiens à dire que si j’ai toujours eut le plus grand respect des autres, approchant toujours mon prochain avec la plus grande déférence, c’est que je les avais toujours considéré comme mes choses à moi, créations personnelles qui m’inspiraient amour et orgueil, sur lesquelles je veillais toujours avec soin ; en amoureux de ma création, je ne haïssais rien ni personne. Bien sûr quand une de mes créatures s’en prend à une autre pour la détruire ou faire souffrir, cela me navre et je ressent cruellement dans la chair de mon esprit comme une entrave dans mon pouvoir créateur. Cependant, mon optimisme ne se laisse pas abattre par toute cette violence, les meurtres et les guerres et les catastrophes naturelles ; mon imagination démiurgique saura parfaire le meilleur des mondes possibles. Du moins le croyais-je encore il n’y a pas si longtemps.
Tout bascula un soir, devant la télévision par laquelle, à l'occasion d'un sitcom, s’ouvrit une première lézarde dans le cosmos de ma conscience. La petite Gracie est une charmante blondinette fragilisée par le décès encore récent de sa maman. Sa petite âme introvertie s'orne une intelligence vive et précoce exaltée par une imagination têtue et charmante; la pauvre enfant compense l'absence de sa mère par la camaraderie complaisante et fidèle d'une amie imaginaire nommée Imogène. Cette amitié ne manque pas de déconcerter l'entourage familial et au premier chef, la sémillante nourrice, Fran Fine embauchée quelque épisodes plus tôt pour assumer des tâches maternelles laissées en plan par la défunte. L'enfant consulte une pédopsychiatre, porte un intérêt passionné pour ces séances et organise des psychothérapies de groupe pour ses poupées.
Un matin je fut renversé par un autobus dont le chauffeur ne m’avait manifestement pas vu. Je m’en sorti avec quelques points de sutures aux urgences. Au physique je m’en tirais avec rien qui ne soit irréversible. Il en allait tout autrement au moral.
A mon réveil à l’hôpital, mes yeux s'ouvrirent pour voir assise à mon chevet ma créature, ma préférée, celle qu’en société j’appelle ma femme; la première chose je lui demandais fut celle ci : « Chérie, répond moi sincèrement, ne fait pas semblant je t’en supplie je veux savoir la vérité ; là, en ce moment, hic et nunc, me voit-tu, m’entends-tu, me sent-tu ? » Je vis un grand trouble sur son visage qu’elle réprima vite par son rire cristallin. « Voyons, chéri, que dis-tu là ? ».Mais j’avais bien sentis qu’elle me cachait quelque chose. Ses attitudes, son comportement avec le docteur et les aides-soignantes me semblait trop bien joué. Dans le ton, dans les gestes il y avait un naturel exagéré ; tout dans leur être semblait déterminé à vouloir faire passer du vrai. J’étais convaincu d’avoir affaire à des experts du mentir-vrai. Cela me demandais de gros efforts intellectuels, une épuisante tension de l’esprit dans laquelle je m’obstinais et qui vidait progressivement ma conscience. Moi qui croyais avoir créé le grandiose univers ; ce cosmos qui rayonnait de ma conscience d’être, moi qui voyait tous le génie humain comme l’excroissance de son souffle créateur ; Lascaux et Borobudur, Shakespeare et les Veda, le CERN et le Parthénon étaient pour moi les avatars de l’Unique principe créateur de mon Ego dilaté. Je comprenais soudain que je n’étais en fait que le petit compagnon imaginaire de tous ces êtres et que, pour des raisons qui me dépassent, ils étaient désormais décidés à se débarrasser de moi. Dans un effort démesuré, ma conscience se dissout dans chaque objet du monde transformé en indice de ce complot cosmique et je vois bien aujourd’hui que chaque atome de l’univers y participe.